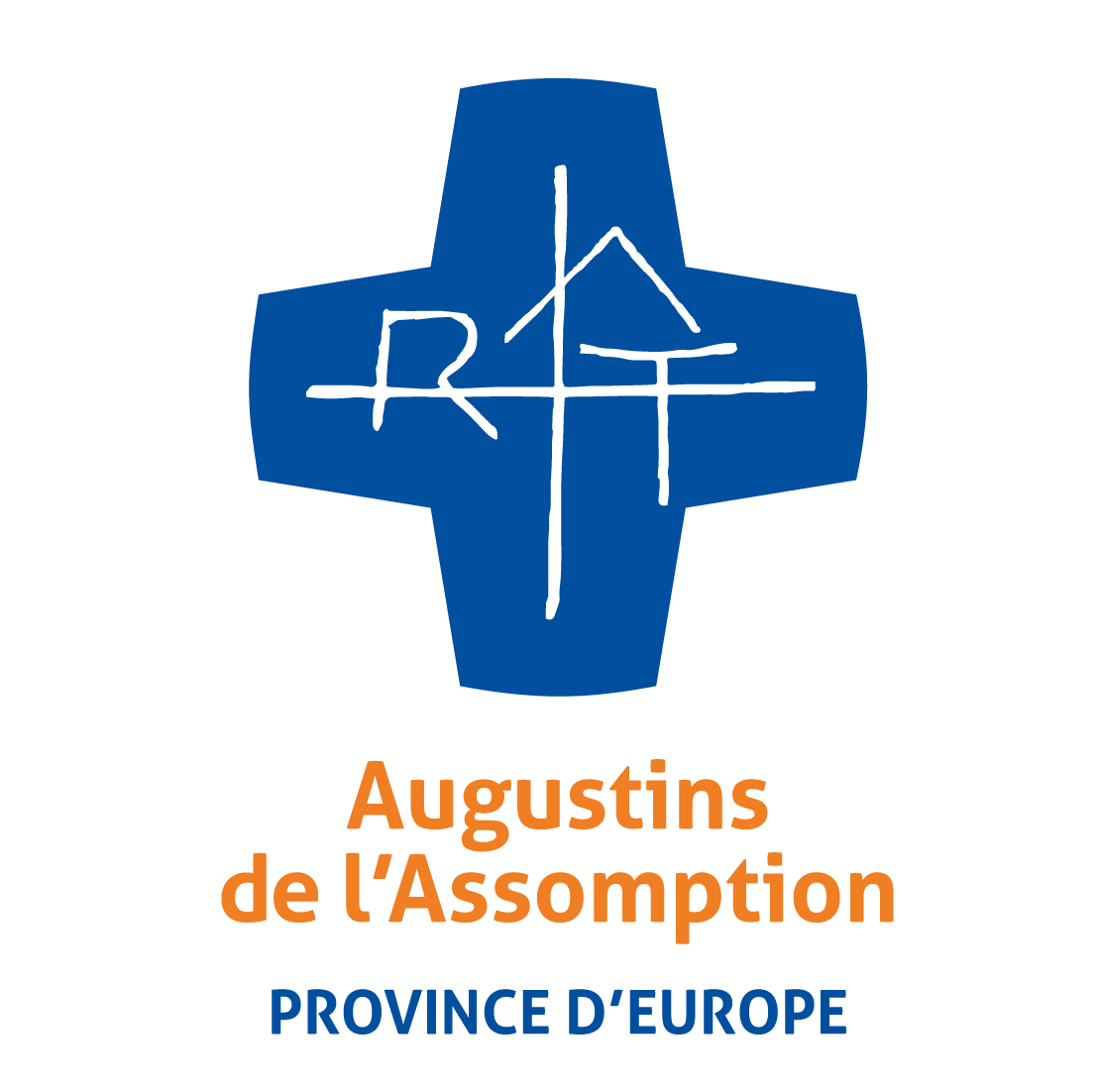L’église Sainte-Marie-Madeleine
L’église Sainte-Marie-Madeleine
La fondation de ce sanctuaire dédié à sainte Marie-Madeleine remonte au treizième siècle, avec la venue de frères de la Miséricorde, encore appelés frères saccites ou sachets, une congrégation de la famille franciscaine, en charge de l’évangélisation des villes. Depuis lors, le sanctuaire a évolué pour devenir, à la fin du quinzième siècle, une chapelle de style gothique.

Durant les seizième et dix-septième siècles, l’histoire de Bruxelles est marquée par de nombreux conflits politiques à incidence religieuse. La Madeleine n’est pas épargnée. Le treize août 1695, l’église est atteinte par le bombardement orchestré par les troupes du Maréchal de France Villeroy qui vise le centre de Bruxelles. L’hôtel de ville est épargné, mais pas les diverses maisons de confréries avoisinantes. Bruxelles se reconstruira très vite, ce qui nous vaut aujourd’hui cette splendide Grand-Place. L’église, pour sa part, n’est que partiellement restaurée, car elle ne dispose pas des riches moyens des guildes de marchands. À la fin du dix-huitième siècle, c’est la Révolution française qui atteint nos régions. L’instabilité politique de l’époque influence aussi la vie de l’Église. La chapelle de la Madeleine est tantôt fermée au culte, tantôt réouverte. En 1841, les Rédemptoristes reprennent le service religieux à la Madeleine et aménagent dans un couvent annexe. Or voilà que, peu avant 1900, il est décidé d’établir une jonction ferroviaire entre les gares du Nord et du Midi. La Madeleine est rachetée et les maisons aux alentours expropriées, en vue de leur démolition. Mais les deux guerres mondiales retardent le projet. Entretemps, nous sommes en 1924, grâce à la venue des religieux assomptionnistes, le culte religieux peut reprendre. En 1937, ils installent la dévotion à sainte Rita, qui fut une religieuse de la même famille augustinienne. Ils sont aussi soutenus par des amis fidèles de la Madeleine, lesquels obtiennent le classement du bâtiment au patrimoine architectural.

Au début des années cinquante, on reparle de la nécessaire réalisation de la jonction ferroviaire et de la construction de la Gare Centrale. Mais le projet a légèrement changé. On effectuera les travaux plus haut que prévu, si bien que les maisons expropriées jadis auraient pu ne pas l’être. La chapelle est ainsi sauvegardée de la démolition pure et simple. Mais voilà ! le bâtiment est en mauvais état et pour le conserver, il faut une restauration complète.
Trois instances sont concernées : l’Office de la Jonction, propriétaire de la chapelle, les Monuments et Sites qui détiennent le décret de classement, et la Ville de Bruxelles qui rêve de grandes artères pour la circulation automobile et qui propose de déplacer l’édifice. Au milieu de ces instances, les religieux n’ont rien à dire! Ils seront pourtant des intermédiaires précieux.
Des propositions de reconstruction n’aboutissent pas. Finalement, un projet de restauration est accepté, lequel devra intégrer la façade baroque et un mur de la chapelle Sainte-Anne située initialement à quelques pas de la Madeleine. La restauration est confiée à l’architecte Simon Brigode. Pour rendre à l’église son aspect initial du 15e siècle, celui-ci va s’inspirer de gravures réalisées après le bombardement de 1695.
Le 21 novembre 1958, l'église restaurée est inaugurée lors d'une célébration solennelle présidée par Mgr J. Suenens.

Les religieux de l'Assomption présents dans cette église depuis 1924 prennent à leur charge le renouvellement du mobilier intérieur et des vitraux de l'église. Conseillés par Simon Brigode, ils prennent contact avec Michel Martens, maître-verrier à Bruges pour la réalisation des vitraux du chœur de l'église. Les contacts vont bon train. Le premier date du 9 septembre 1957. On décide assez rapidement de la thématique : l’histoire du salut à travers le personnage de sainte Marie-Madeleine. Un an plus tard, lors de l’inauguration, tout est en place. Les vitraux sont installés. Les nouvelles orgues, fabriquées par l’entreprise Verschueren, peuvent résonner, une statue de sainte Rita est placée sur son socle dans la chapelle qui lui est dédiée. Une icône de la Vierge, “Salus populi romani” (« Sauvegarde du peuple romain ») a pris place au-dessus d’un autel latéral. Plus récemment, deux icônes réalisées par Luisanna Garau (Italie) ont été installées, la croix dans le choeur, l’icône de la Trinité à gauche du choeur. L’autel actuel est aussi récent (2010). Il est l’œuvre du sculpteur Michel Smolders, lequel a aussi réalisé la statue du P. Damien installée dans une des nefs latérales.