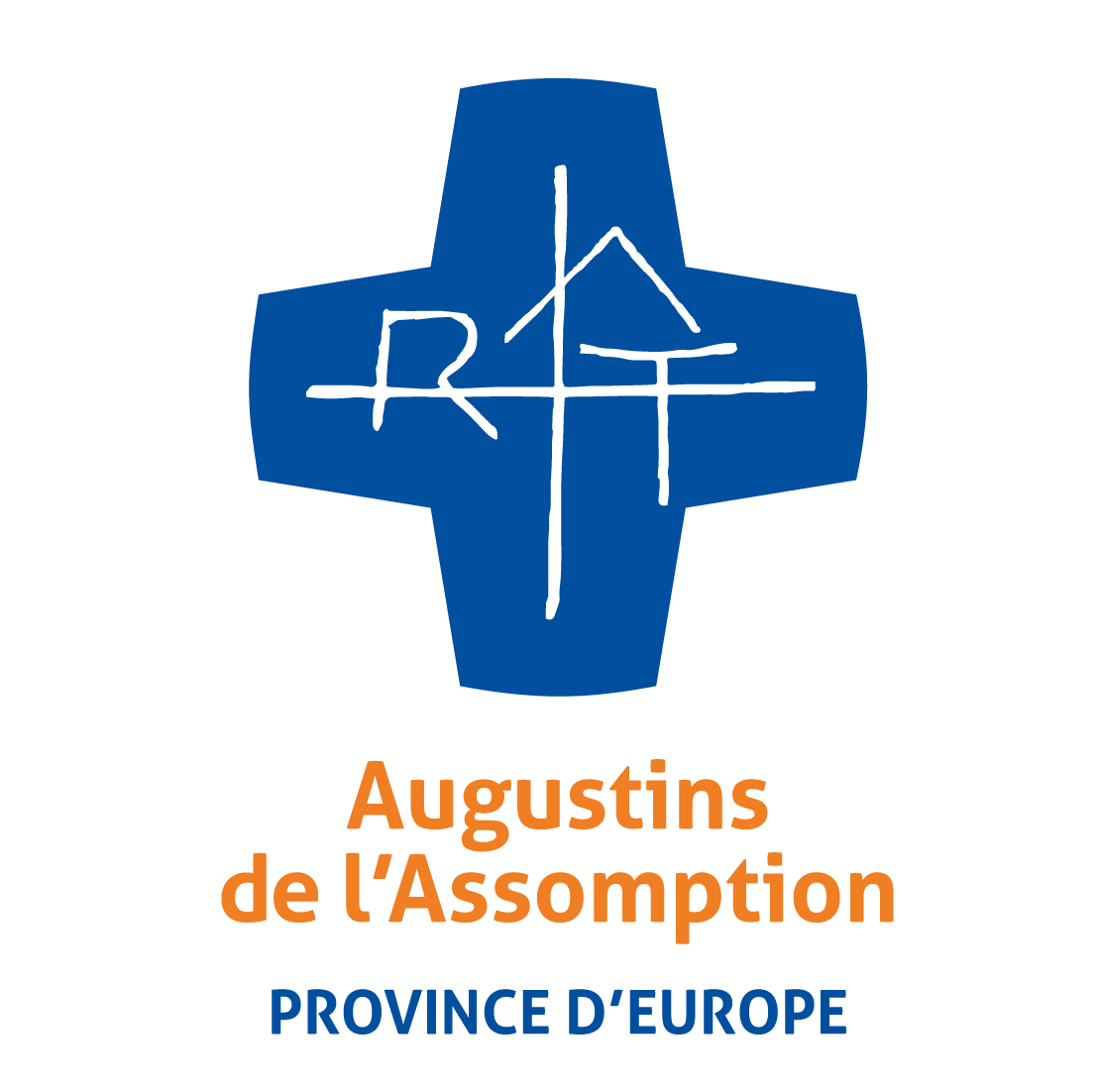Le Centenaire de la présence assomptionniste à Bruxelles
L’arrivée des assomptionnistes à Bruxelles
Dès la fin du 19e siècle, les assomptionnistes envisagent de s’établir en Belgique. Le climat politique en France devient en effet très défavorable à l’Église et, en particulier, aux instituts religieux. Sous l’impulsion du P. Picard, premier successeur du P. d’Alzon, le fondateur de la congrégation des Augustins de l’Assomption (assomptionnistes), une première maison religieuse – un alumnat (sorte de petit séminaire) – s’ouvrit en 1891 à Taintignies, non loin de Tournai, dans le Hainaut. Un jugement prononçant la dissolution de l’Assomption de France en janvier 1900 accéléra le mouvement. Des communautés s’établirent à Bure, Louvain, Zepperen et Sart-les-Moines, notamment. Toutes ces fondations étaient orientées vers l’enseignement et la formation des jeunes religieux.

En 1923, un chapitre de congrégation opéra une importante réorganisation, dans le cadre de laquelle fut créée une province belgo-hollandaise. Et, en novembre 1924, le premier supérieur provincial, le P. Remy Kokel, s’établit à Bruxelles, dans le couvent (aujourd’hui disparu) attenant à l’église de la Madeleine, puis dans une maison de la rue Duquesnoy, qui devint rapidement le centre de diverses œuvres apostoliques.
A la même époque, d’autres communautés assomptionnistes s’établirent en Belgique, en particulier celle qui se mit au service de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption à Woluwé-Saint-Lambert.

Les assomptionnistes à Woluwe-Saint-Lambert
Dans les premières années du 20e siècle, Woluwe-Saint-Lambert, commune de la périphérie Est de Bruxelles, présentait encore un visage campagnard. Mais, dès les années 20, l’urbanisation progressait. Un nouveau quartier s’édifiait sur le lieudit Kapelleveld. Le cardinal Mercier, archevêque de Malines-Bruxelles suscita la création d’une nouvelle paroisse pour desservir ce quartier et en confia la charge aux assomptionnistes. Dès Noël 1924, le P. Louis-Antoine Verhaegen assura régulièrement le service religieux dans la chapelle Marie-la-Misérable et, en février 1925, la paroisse était canoniquement érigée sous le patronage de Notre-Dame de l’Assomption. Très vite, la chapelle ne suffit plus à accueillir les fidèles et la construction d’une église paroissiale fut entreprise.

Les assomptionnistes et Marie-la-Misérable (1924-2015)
Le 2 décembre 1925, le marquis de la Boëssière-Thiennes, propriétaire de la chapelle Marie-la-Misérable et de la maison attenante, en fait don aux assomptionnistes, permettant ainsi la fondation de la nouvelle paroisse du quartier Kapelleveld en plein développement.
Antoine Verhaegen, curé de la nouvelle paroisse, y célébrait déjà depuis Noël 1924. En 1926, il procède à la restauration de la maison et agrandit la chapelle sans toutefois modifier son aspect extérieur, protégé par le classement. La chapelle servira d’église paroissiale jusqu’à l’achèvement de l’église Notre-Dame de l’Assomption, en avril 1927. De 1927 à 1936, la maison abrite les deux religieux assomptionnistes qui desservent la paroisse.
A partir de 1949, la maison héberge une communauté assomptionniste élargie, dont les membres assurent divers apostolats : presse, enseignement, pèlerinages, pastorale paroissiale, etc.
En 1966, une restauration de la chapelle est entreprise à la suite de dégâts provoqués par un violent orage. A cette occasion des vestiges de fresques du 14e siècle ont été découvertes.

Lors de la scission de la province assomptionniste de Belgique, en juin 1963, la maison provinciale de Belgique-Nord est établie dans les locaux de Marie-la-Misérable. Elle y restera jusqu’en 1978. Les religieux de la communauté assument la responsabilité de la pastorale bilingue de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption jusqu’en 1974. A cette époque, les pastorales francophone et néerlandophone de la région bruxelloise sont séparées. A Notre-Dame de l’Assomption, la première est assurée par un prêtre diocésain tandis que la seconde est exercée par des assomptionnistes jusqu’en 1979. Les activités de la communauté de Woluwe deviennent alors indépendantes de la paroisse. Les deux derniers religieux flamands quittent Woluwe en 2015.
Les assomptionnistes et l’église Sainte-Marie-Madeleine
Lorsque les Assomptionnistes arrivent à Bruxelles, les autorités ecclésiastiques leur permettent de reprendre le culte dans l’église Sainte‐Marie‐Madeleine, qui, en 1905, avait été abandonnée par les religieux rédemptoristes qui y assuraient le service depuis 1841. Dans la perspective, déjà évoquée, de la jonction ferroviaire entre les gares Nord et Sud de Bruxelles, l’église avait en effet été rachetée par l’Office de la Jonction en vue de sa future démolition. La guerre de 14‐18 a retardé le projet, tandis que l’église et le couvent adjacent sont occupés par des religieuses. La venue des Assomptionnistes est providentielle, et le culte peut donc reprendre. Bientôt, ils abandonnent à leur tour le couvent annexe et installent leur domicile dans une maison de la rue Duquesnoy, à 200 mètres de là. Les religieux qui y demeurent s’activent non seulement pour le service dans l’église, mais aussi pour bien d’autres œuvres : presse, pèlerinages, librairie religieuse, patronage de divers métiers et confréries, etc.

Un peu avant 1940, les religieux installent dans l’église la dévotion à sainte Rita, religieuse de la même famille augustinienne qu’eux-mêmes. Puis vient la guerre de 40‐45. C’est à cette époque qu’un édit de classement est émis : l’église ne pourra plus être détruite. Le service du culte peut se poursuivre et demeure encore aujourd’hui, même si les activités se sont fortement réduites. Il sera suspendu pendant un peu plus d’une année lors de la restauration complète de l’édifice en 1957‐1958.