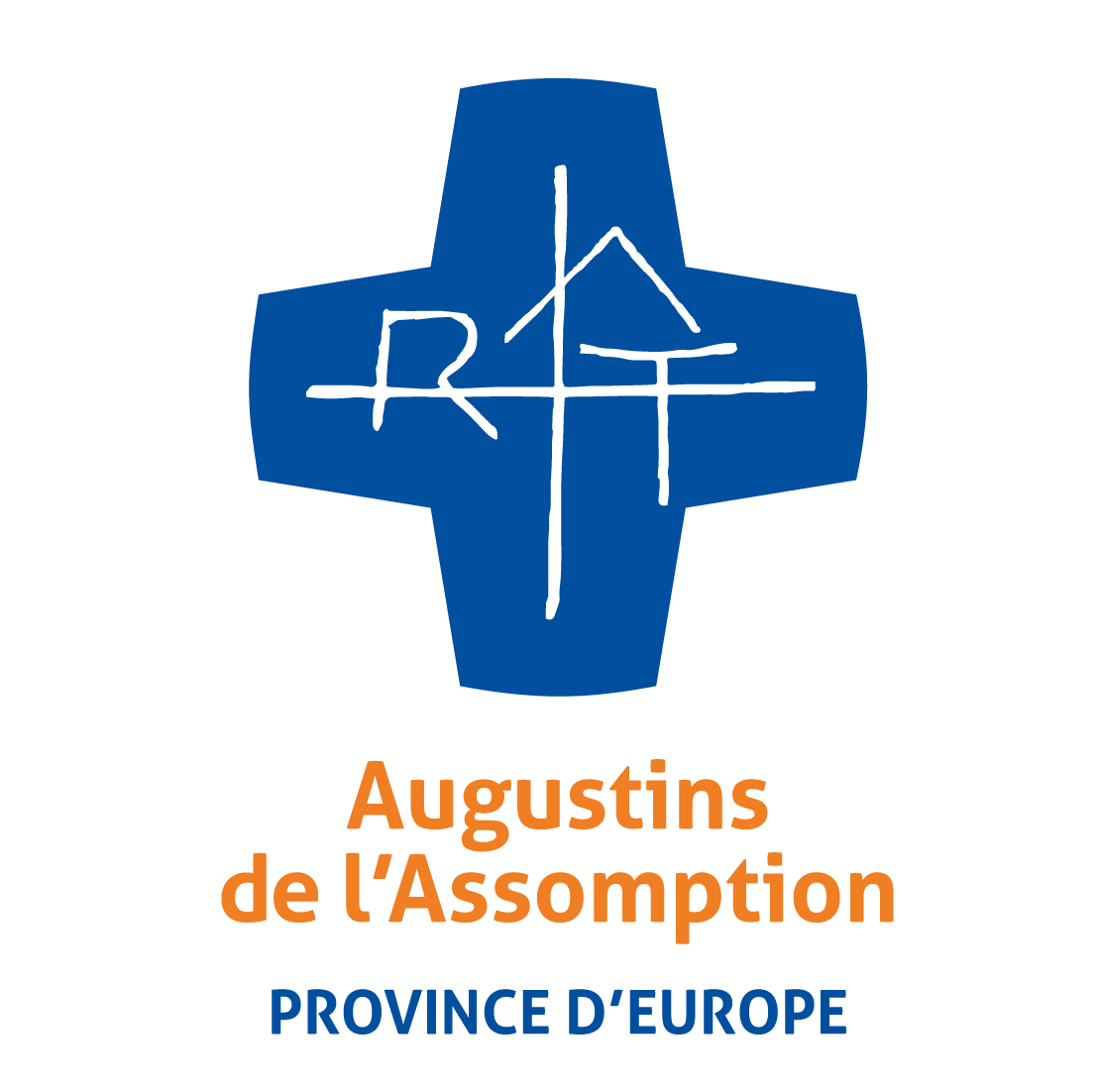Une brève histoire de l’Assomption
Une brève histoire de l’Assomption
En 1845, au cœur d’un siècle qui a vu naître beaucoup de nouvelles congrégations religieuses, Emmanuel d’Alzon a fondé les Augustins de l’Assomption (assomptionnistes). Cet homme au fort tempérament voulait une « congrégation moderne » pour renouveler l’esprit catholique dans la société. Marqué par les divisions qui régnaient dans le monde, le P. d’Alzon s’employa à promouvoir l’unité et la réconciliation. Avec ses premiers religieux, il s’investit dans l’éducation, prenant la tête du Collège de l’Assomption à Nîmes. Il voulait que la jeunesse transforme la société par l’engagement social autant que par la diffusion de la Bonne Nouvelle. Soucieux de défendre la « vérité catholique », Emmanuel d’Alzon se tourna aussi vers l’Orient. Encouragé par le Pape Pie IX, il envoya des religieux en Bulgarie et en Turquie. Un autre pilier de l’apostolat de l’Assomption fut la création de la « Bonne Presse », l’actuel Bayard Presse. Une œuvre pour promouvoir l’esprit chrétien et contribuer à la formation des hommes et des femmes de notre temps.
A la mort du Fondateur, en 1880, la congrégation compte 68 religieux et 11 novices. C’est après son décès qu’elle connaît un développement significatif. Ce sont les alumnats, sortes de petits séminaires pour jeunes venant de familles modestes, qui fourniront la majorité des vocations à l’Assomption. Au milieu du XXe siècle, la congrégation atteint un pic de presque 2000 religieux

Le P. François Picard, qui succède au P. d’Alzon, contribue au développement des grandes œuvres de la congrégation. A la Bonne Presse, Le Pèlerin (fondé en 1873) et La Croix, qui devient un quotidien en 1883. Dans le quart de siècle qui suivit, plus de 30 titres de publications vont voir le jour. Il y a aussi les pèlerinages à Lourdes, à Rome et à Jérusalem, où les assomptionnistes accompagnent des foules de pèlerins. La Mission d’Orient, débutée en Bulgarie et en Turquie, se développe (Russie, Roumanie…). Enfin, la fondation du Collège Saint-Augustin à Plovdiv, en Bulgarie, est un nouveau fleuron dans la mission éducatrice de la congrégation.
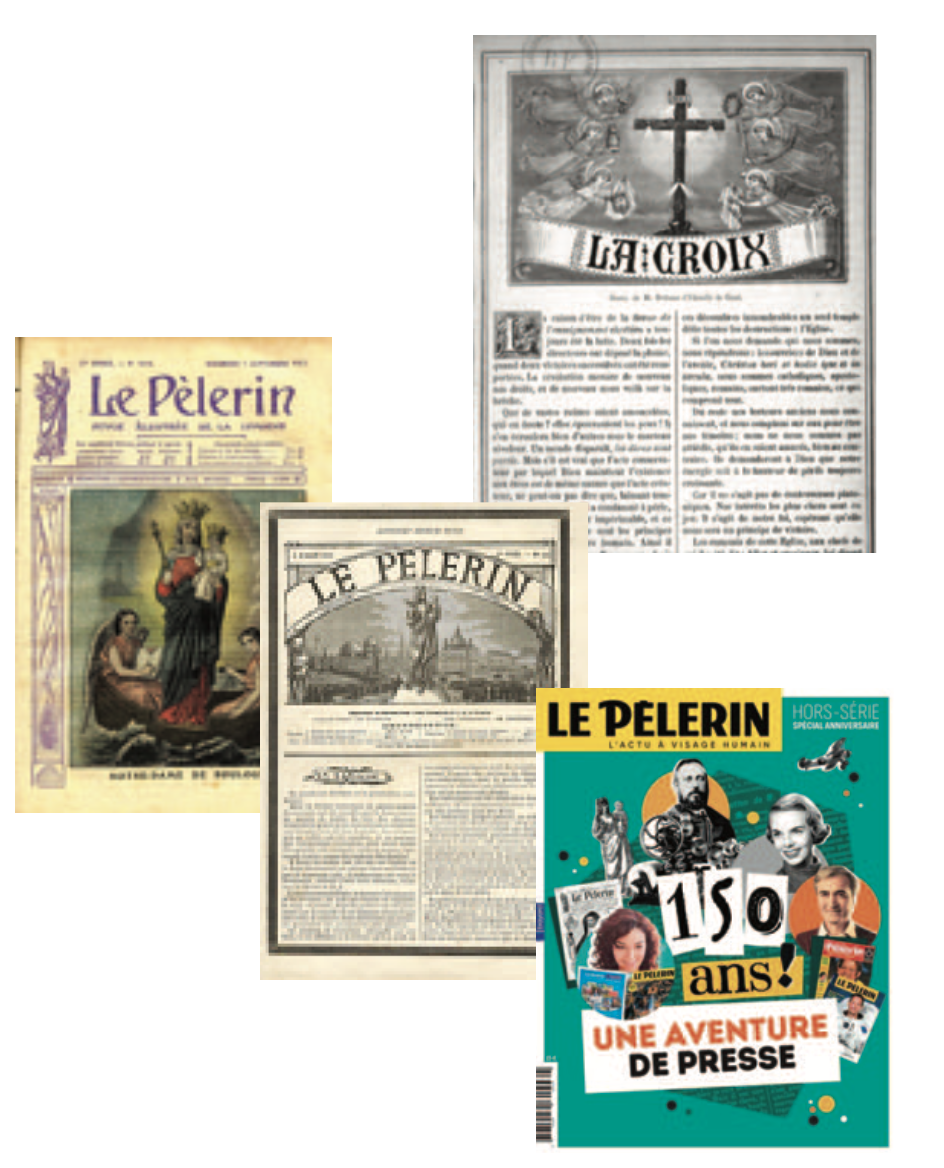
En France, la 3e République est particulièrement anticléricale. Dès 1880, des religieux sont expulsés de leur communauté. En 1900, la congrégation est dissoute et les assomptionnistes expulsés hors de France. Ils sont sans doute particulièrement visés en raison de l’influence importante de leurs organes de presse, spécialement La Croix. Cependant, comme ce fut le cas pour d’autres congrégations françaises, cette persécution a contribué au déploiement international des assomptionnistes, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord…
Sous le P. Emmanuel Bailly (du début du XXe siècle à la fin de la première guerre mondiale) la congrégation connaît la double épreuve de la dispersion et de la guerre, avec notamment le démantèlement des communautés et des œuvres en Turquie et en Bulgarie (où œuvraient avant la guerre jusqu’à 150 religieux et 200 sœurs Oblates de l’Assomption) et, bien sûr, la mort sur les champs de bataille d’un bon nombre de jeunes religieux et le saccage ou la spoliation du patrimoine immobilier dans plusieurs pays. La guerre eut cependant aussi un effet positif pour l’Assomption. Les religieux qui avaient rempli leur devoir militaire en France furent autorisés à y rester. Mais, pour diverses raisons, la congrégation n’obtiendra sa reconnaissance officielle par l’État français qu’en 2013 soit 168 ans après sa fondation !
De la fin de la première guerre mondiale au concile Vatican II, l’Assomption connut des années d’expansion et d’aventure missionnaire (avec bien sûr la parenthèse de la seconde guerre mondiale): relance de la présence dans la Mission d’Orient ; fondations au Congo-Belge, en Afrique du Nord, en Chine, à Madagascar et en Afrique de l’ouest… Ce fut aussi le temps de la persécution dans les pays du bloc soviétique… Plusieurs religieux seront déportés dans des camps de travaux forcés et trois d’entre eux, reconnus martyrs de la foi, seront condamnés à mort en 1952 en Bulgarie. Ce sera aussi l’époque du déploiement des Études Augustiniennes et des Études Byzantines, avec des bibliothèques spécialisées, des revues scientifiques et des chercheurs assomptionnistes qui deviendront de grandes figures, spécialistes d’Augustin et du monde Byzantin.
L’après Concile sera un temps d’épreuve avec de nombreux départs mais aussi un temps de renouveau qui conduira, dans les années 80, à un retour des orientations fondamentales augustiniennes et alzoniennes et à un renouvèlement de la pastorale des jeunes et des vocations.
Enfin, les années 2000 seront marquées par le développement en Asie, le retour en Afrique de l’Ouest et une animation beaucoup plus internationale de la congrégation.